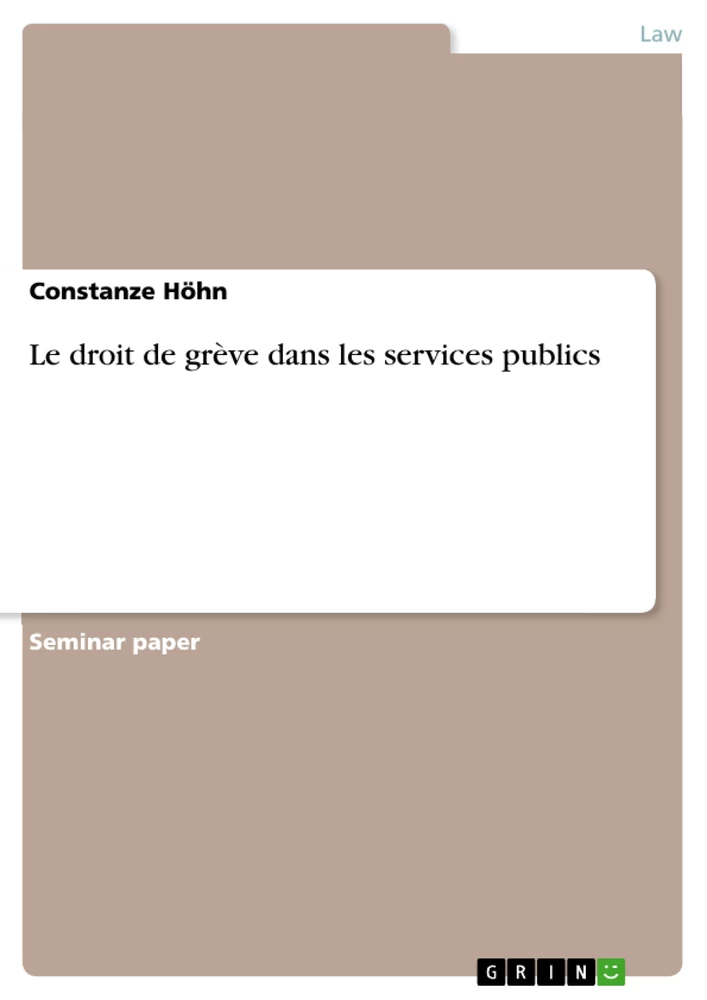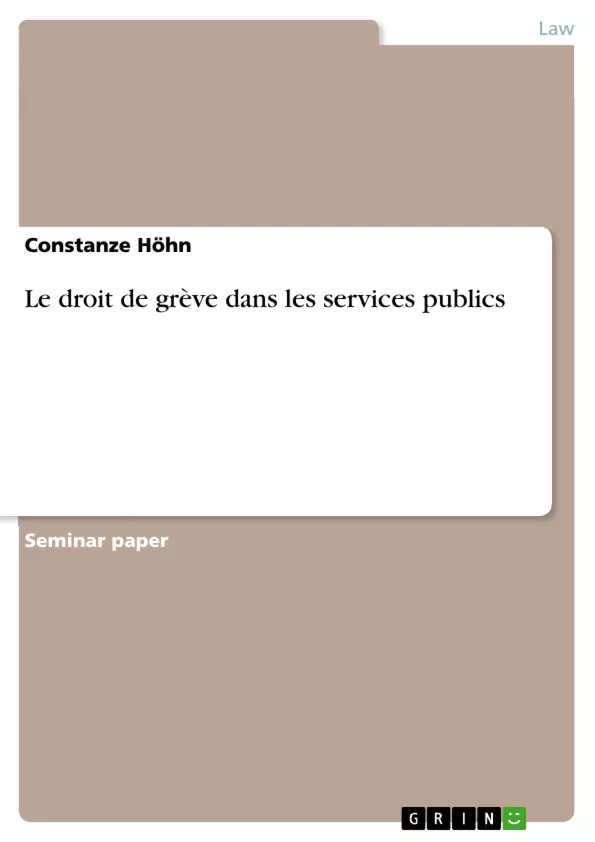Selon alinéa 7 du préambule de 1946 « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Jusqu’au milieu du 20ème siècle le droit de grève est resté contesté aux fonctionnaires, pendant que la loi du 21 mars 1884 l’a reconnu aux salariés du secteur privé. La grève était vue comme dangereuse dans le secteur des services publics ayant comme but la satisfaction de l’intérêt général. Selon Rolland les services publics reposent sur quatre piliers, dont celui de la continuité, qui impose un fonctionnement régulier des services, sans interruptions. En conséquence, la grève qui se définit comme cessation collective et concentrée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles, semble inconciliable avec le principe de la continuité. Il en résultait que le droit de grève était pendant une longue période interdit aux fonctionnaires au nom du principe de continuité. Malgré l’interdiction des syndicats dans les fonctions publiques ils se sont développés dans les fonctions publiques avant leur reconnaissance officielle en 1945. La grève est la conséquence logique du syndicalisme et on ne pouvait pas tolérer les syndicats pendant qu’on interdisait la grève. D’ailleurs, il faut tenir compte du fait que malgré l’interdiction officielle de la grève, certaines très dures se sont développées et ont porté atteinte à la continuité dans les premières années du XXe siècle. Dans ces cas l’aspiration au droit de grève a primé le droit. Il en résulte que l’interdiction totale de la grève risque ainsi d’être dépourvue d’une efficacité totale.
C’est aussi dû à l’extension continue du champ des services publics que l’interdiction totale de la grève ne semble justifiable que dans les cas des services fondamentaux. Finalement, grâce à la disposition relative au droit de grève dans le préambule de 1946, le droit de grève est aussi reconnu dans le service public par le Conseil d’État en 1950 . Le principe de la continuité de l’Etat a été toujours reconnu comme supérieur au droit de grève jusqu’au moment ou le droit de grève est érigé en principe constitutionnel (I) et empiète désormais sur la suprématie apparente de la continuité de l’État ce qui nécessite une conciliation des deux principes (II).
Inhaltsverzeichnis
- I. Le droit de grève vis-à-vis du principe de la continuité : un rapprochement difficile de deux principes contradictoires.
- A. Le principe de continuité comme empêchement au droit de grève
- B. La fin de la suprématie du principe de la continuité
- II. La conciliation du droit de grève et du principe de continuité : La limitation du droit de grève.
- A. La limitation du droit de grève par la loi
- B. La limitation du droit de grève par la voie réglementaire
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und den aktuellen Stand des Streikrechts im französischen öffentlichen Dienst. Sie analysiert den Konflikt zwischen dem Prinzip der Dienstkontinuität und dem verfassungsrechtlich garantierten Streikrecht und beleuchtet die verschiedenen Mechanismen zur Vereinbarkeit beider Prinzipien.
- Entwicklung des Streikrechts im französischen öffentlichen Dienst
- Konflikt zwischen Streikrecht und Dienstkontinuität
- Rolle des Conseil d'État und des Conseil constitutionnel
- Gesetzliche und verordnungsrechtliche Regulierung des Streikrechts
- Mechanismen zur Sicherstellung eines Mindestdienstes
Zusammenfassung der Kapitel
I. Le droit de grève vis-à-vis du principe de la continuité : un rapprochement difficile de deux principes contradictoires.: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung des Streikrechts im französischen öffentlichen Dienst. Zunächst wird die lange Zeit bestehende vollständige Streikverbote aufgrund des Prinzips der Dienstkontinuität dargestellt, deren Begründung und Auswirkungen. Anschließend wird der Paradigmenwechsel durch die Verankerung des Streikrechts im Präambel der Verfassung von 1946 und die damit einhergehende juristische Auseinandersetzung zwischen dem Streikrecht und dem Prinzip der Dienstkontinuität detailliert erklärt. Der Fokus liegt auf der Rechtsprechung des Conseil d’État und des Conseil constitutionnel und deren Interpretation der beiden sich widersprechenden Prinzipien.
II. La conciliation du droit de grève et du principe de continuité : La limitation du droit de grève.: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Maßnahmen zur Begrenzung des Streikrechts im öffentlichen Dienst. Es wird untersucht, inwieweit der Gesetzgeber durch die Einführung von Mindestdienstregelungen, Fristen und anderen Einschränkungen eine Vereinbarkeit von Streikrecht und Dienstkontinuität erreichen konnte. Weiterhin wird der Beitrag der Rechtsprechung bei der Auslegung und Anwendung dieser Regelungen analysiert. Dabei wird die Rolle der Verwaltung bei der Festlegung und Umsetzung von Mindestdiensten und die gerichtliche Kontrolle dieser Maßnahmen kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
Streikrecht, öffentlicher Dienst, Frankreich, Dienstkontinuität, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Mindestdienst, Gesetzgebung, Rechtsprechung, Verfassung, Verfassungsrecht.
FAQ: Analyse des französischen Streikrechts im öffentlichen Dienst
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung und den aktuellen Stand des Streikrechts im französischen öffentlichen Dienst. Sie konzentriert sich auf den Konflikt zwischen dem Prinzip der Dienstkontinuität und dem verfassungsrechtlich garantierten Streikrecht und untersucht die Mechanismen zur Vereinbarkeit beider Prinzipien.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Streikrechts, den Konflikt zwischen Streikrecht und Dienstkontinuität, die Rolle des Conseil d'État und des Conseil constitutionnel, die gesetzliche und verordnungsrechtliche Regulierung des Streikrechts sowie Mechanismen zur Sicherstellung eines Mindestdienstes.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptkapitel. Kapitel I behandelt den schwierigen Ausgleich zwischen Streikrecht und dem Prinzip der Dienstkontinuität, einschließlich der historischen Entwicklung und der Rechtsprechung des Conseil d’État und des Conseil constitutionnel. Kapitel II befasst sich mit der Begrenzung des Streikrechts durch gesetzliche und verordnungsrechtliche Maßnahmen, einschließlich Mindestdienstregelungen und der gerichtlichen Kontrolle dieser Maßnahmen.
Was sind die Kernaussagen von Kapitel I?
Kapitel I beschreibt die historische Entwicklung, beginnend mit der lange Zeit bestehenden vollständigen Streikverbote aufgrund des Prinzips der Dienstkontinuität. Es beleuchtet den Paradigmenwechsel durch die Verankerung des Streikrechts in der Verfassung von 1946 und die damit verbundene juristische Auseinandersetzung. Der Fokus liegt auf der Rechtsprechung des Conseil d’État und des Conseil constitutionnel und deren Interpretation der beiden widersprüchlichen Prinzipien.
Was sind die Kernaussagen von Kapitel II?
Kapitel II untersucht die gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Maßnahmen zur Begrenzung des Streikrechts. Es analysiert, wie der Gesetzgeber durch Mindestdienstregelungen, Fristen und andere Einschränkungen eine Vereinbarkeit von Streikrecht und Dienstkontinuität erreichen wollte. Die Rolle der Rechtsprechung bei der Auslegung und Anwendung dieser Regelungen sowie die Rolle der Verwaltung und die gerichtliche Kontrolle werden kritisch beleuchtet.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind Streikrecht, öffentlicher Dienst, Frankreich, Dienstkontinuität, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Mindestdienst, Gesetzgebung, Rechtsprechung, Verfassung und Verfassungsrecht.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Juristen, Studierende und alle, die sich für das französische Streikrecht und die Rechtsprechung im öffentlichen Dienst interessieren.
- Quote paper
- Constanze Höhn (Author), 2009, Le droit de grève dans les services publics, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/189058